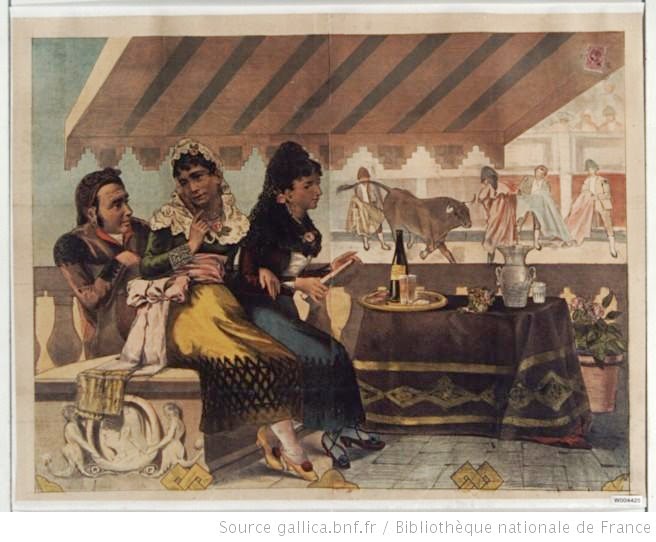|
Entrefilet paru dans
l’ABC du 5 janvier
1965
|
La vie taurine mexicaine a connu des épisodes particulièrement
tumultueux.
De l’histoire qui suit, il existe presque autant de versions que de
narrateurs, la confusion ayant été savamment entretenue par tous les
protagonistes de l’affaire…
On est en 1964. Ángel Vázquez
est à la tête de la plaza Mexico. Il est aussi apoderado de Paco Camino avec Manolo Chopera qui ne manque pas de
lui vendre en lot ses autres poulains (El Cordobes, Victoriano Valencia, Fermin
Murillo, etc.) que Vázquez n’oublie jamais de programmer dans son chaudron. En
revanche, il semble beaucoup plus distrait quand il s’agit de payer leur dû aux
subalternes mexicains qui commencent à s’en irriter sérieusement.
En parallèle, l’Union Mexicaine des Picadors et Banderilleros
Mexicains lutte pour quelques autres bagatelles. Par exemple, en interne, pour désigner leur
secrétaire général (ils ont fini par se mettre d’accord après diverses violentes algarades
et quelques passages à tabac). Ou encore, en externe, pour obtenir les mêmes « privilèges »
que les espagnols. Entendez par là que les subalternes mexicains revendiquaient
le droit d’être payé au même tarif que les subalternes européens :
embauchés en qualité de troisième banderillero dans les cuadrilles des
matadores espagnols, ils demandaient à être payés au même tarif que les deux
premiers.
Or, au moment du renouvellement de l’Accord Collectif
entre les différentes instances du mundillo
international, la Unión Mexicana de
Picadores y Banderilleros exige que la dette contractée à l'égard de ses adhérents par l’empresa de la Monumental soit précisément mentionnée dans le texte. Le sieur
Vázquez refuse et assure lâchement ses arrières avec une clause disposant que
l’accord signé prévaudrait sur toutes querelles d’ordre privé ou syndical.
Les turbulents
subalternes avaient certes une manière virile et peu reluisantes de régler leurs
différends en interne mais ils savaient être solidaires quand il s’agissait de défendre
leurs droits face au reste du monde.
La riposte ne se fait dès lors pas attendre : la Unión se met en grève jusqu’à ce
que l’Accord soit rompu. Comme les subalternes espagnols sont tenus d’adhérer à
l’Union Mexicaine lorsqu’ils travaillent en terre aztèque (l’inverse est
également vrai quand les mexicains sont en Espagne), ils sont contraints à la
grève par capillarité.
Les premières courses de la Temporada
Grande ont donc lieu avec des matadores accompagnés de cuadrillas composées de… novilleros !
Le ménage Vázquez-Chopera contre-attaque en
faisant appel à des « cuadrillas
libres », ce qui en langage populaire signifie « libres de ne pas
leur causer de tracas avec les exigences saugrenues du Syndicat » et c’est
ainsi qu’est annoncé le cartel du dimanche
3 janvier 1965 : 6 toros de Javier Garfias pour Joselito Huerta, Victoriano
Valencia qui confirme, y Jaime Rangel.
 |
Ignacio Navarro
Rios "El Jitoatero",
outré par la riposte des granaderos
envers les membres de la Unión
Monumental
Plaza México - Le
3 janvier 1965
|
Pour la Unión,
c’en est trop. Cette course ne doit pas avoir lieu.
Lorsque Gabriel Márquez, piquero espagnol de la cuadrilla
de Victoriano Valencia, entre pour piquer le premier toro, Felipe Bedoya
“El Hielero” et Antonio Martinez “La Cronica” se jettent en piste et désarçonnent le traitre. Pendant que
les granaderos (la guardia civil mexicaine) se chargent de
ces deux-là, Agustín Salgado “Muelon” déboule sur le ruedo avec quelques autres comparses. C’est la foire d’empoigne et
les représentants de l’ordre laissent s’en donnent à cœur joie.
Après la prison, c’est l’heure des tractations. Mieux
vaut ne pas s’appesantir sur ces dernières si l’on tient à conserver ce qu’il
nous reste de foi en la nature humaine…
Gabriel Márquez n’a pas piqué ce jour-là, mais l’Accord
n’a finalement jamais été rompu.
Zanzibar











.jpg)